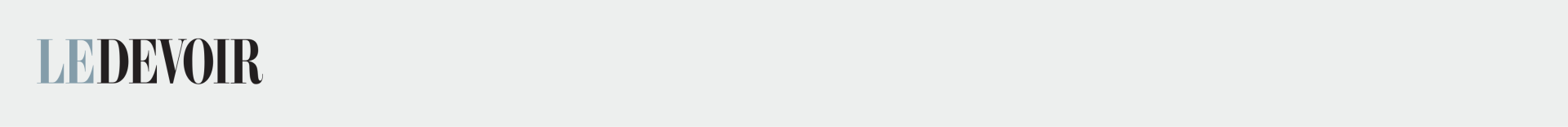
Alexis St-Maurice
L’auteur est diplômé à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal.
La STM affiche les symptômes d’une gouvernance déconnectée

Dans les dernières années, la Société de transport de Montréal (STM) multiplie les décisions problématiques, révélant non seulement une rigidité de plus en plus assumée, mais aussi un amateurisme de gestion qui mine la confiance des citoyens, des travailleurs et des partenaires communautaires.
Qu’il s’agisse de la récente interdiction du flânage dans le métro (mars 2025), du refus de publier une publicité dénonçant les inégalités tarifaires (2022), de la refonte controversée du réseau d’autobus dans l’ouest de la ville (2024) ou du mépris affiché envers ses employés en négociation dans les derniers mois, la STM semble avancer à reculons, s’éloignant chaque jour un peu plus de sa mission première : offrir un service de transport collectif accessible, humain et équitable.
Une « obligation de circuler » contre-productive
Prenons d’abord la question de l’itinérance. En mars dernier, la STM a imposé une mesure d’exception : l’interdiction pure et simple de flâner dans ses stations. Officiellement justifiée par des enjeux de sécurité — « près de la moitié des usagers ne se sentiraient plus en sécurité » —, cette politique a surtout agi comme un outil brutal d’exclusion. Derrière l’expression aseptisée d’« obligation de circuler » se cache une politique répressive visant directement les personnes en situation d’itinérance, sans solution de rechange.
Selon plusieurs organismes de terrain, cette mesure a causé une hausse de la détresse psychologique, de l’agressivité et une perte de repères pour les plus vulnérables. Les personnes nouvellement à la rue, déplacées sans savoir où aller, ont été les plus touchées. Le lien de confiance avec les intervenants de rue, difficile à établir en temps normal, a été brisé.
Et pour quoi ? A-t-on réellement accru la sécurité dans le métro ? A-t-on allégé les pressions sociales ou amélioré la cohabitation ? Rien n’indique que ces objectifs aient été atteints, et la STM refuse toujours de faire un réel bilan transparent de cette politique autoritaire, qui semble surtout avoir servi à plaire à certains usagers inquiets, au prix de l’humanité et de l’efficacité.
Des travailleurs dénigrés, une direction déconnectée
Pendant ce temps, les relations de travail se détériorent. Pour la première fois en 40 ans, les membres du personnel administratif, technique et professionnel de la STM ont voté un mandat de grève. Et ce, à 87 %. Pourquoi ? Parce qu’après un an de négociations et 28 rencontres, l’employeur n’a toujours pas présenté l’ensemble de ses demandes. Les enjeux fondamentaux — vacances, congés, retraite progressive — n’ont même pas été abordés. L’impasse est telle que le syndicat évoque un climat de mépris.
Cerise sur le gâteau : alors que la STM propose à ses employés des augmentations de 2 % à 2,5 % par année, sa directrice générale a vu sa rémunération grimper de 6,5 %, pour atteindre 474 000 $. Ce genre d’écart, en pleine période d’austérité annoncée, nourrit à juste titre la colère. On exige de la rigueur aux travailleurs, mais on se l’autorise rarement en haut de la pyramide.
Un sous-financement qui freine la STM
Il est important de souligner que la STM n’est pas la seule institution fautive. Malgré ses appels répétés à l’aide, elle continue de faire face à un sous-financement préoccupant, qui exacerbe une crise déjà bien ancrée. Alors que les besoins en transport collectif n’ont jamais été aussi pressants dans la métropole, le gouvernement de la Coalition avenir Québec tarde à offrir un soutien financier à la hauteur des enjeux.
En 2024, la STM a dû jongler avec un déficit structurel estimé à plus de 80 millions de dollars, en partie en raison de la baisse d’achalandage postpandémique et de l’augmentation des coûts d’exploitation. Pourtant, les sommes versées par Québec n’ont pas suivi la cadence. Les montants alloués dans les derniers budgets sont jugés insuffisants pour qu’on puisse maintenir le niveau de service actuel, sans parler d’envisager des améliorations ou des extensions du réseau.
Le manque d’investissement menace directement la qualité du service : réduction de la fréquence des passages, compressions dans le personnel, reports de projets d’entretien ou de modernisation. Ce désengagement compromet les efforts de transition écologique, alors que le transport collectif devrait être au cœur des stratégies de lutte contre les changements climatiques.
La STM nécessite une entente de financement stable et prévisible. Pour plusieurs observateurs, il est temps que le gouvernement reconnaisse le transport en commun non comme une dépense, mais comme un investissement essentiel dans la vitalité économique et sociale de la grande région montréalaise.
Il est temps de recentrer la STM sur sa mission
La STM traverse une crise de légitimité. Au-delà du sous-financement gouvernemental, elle prend des décisions qui affectent négativement les plus vulnérables, elle censure les critiques pourtant constructives, elle impose des changements contestés et elle néglige le dialogue avec ses propres employés. Tout cela dénote un problème plus profond : une gouvernance enfermée dans une logique technocratique, éloignée de sa base sociale.
Le transport collectif ne peut pas être géré comme une entreprise privée cherchant à optimiser son rendement. Il s’agit d’un service public dont la mission dépasse les enjeux d’efficacité : il doit être accessible, juste, inclusif. Et pour cela, il faut cesser de voir les usagers, les itinérants et les travailleurs comme des obstacles. Ce sont eux, au contraire, qui donnent vie au réseau. Il est temps que la STM les écoute enfin.